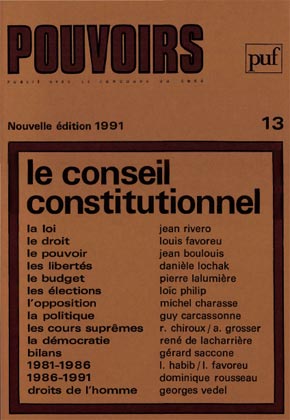Le Conseil constitutionnel
« A vrai dire, l’histoire constitutionnelle de la France n’était pas dépourvue d’éléments comiques… Pourtant, la page la plus ridicule de cette histoire restait à écrire », estime ici René de Lacharrière. Jean Rivero souligne à l’opposé que le Conseil constitutionnel a permis de « parachever la construction en France de l’Etat de droit ». Louis Favoreu considère que le Conseil opère, par sa jurisprudence, la « réunification du droit public », sous l’égide du droit constitutionnel qui « conditionne désormais étroitement le droit administratif, les libertés publiques et les finances publiques », tandis qu’Alfred Grosser révèle sa timidité comparée à ses homologues américain ou allemand.
On pourrait multiplier ainsi les contrastes. Il est un point sur lequel, pourtant, tous semblent s’accorder : le rôle décisif joué aujourd’hui par une institution qui peut s’opposer au Parlement, donc à la majorité, donc au pouvoir. En matière d’association (1971), de juge unique (1975), fouille des véhicules (1977), vote plural des employeurs (1979), internement des étrangers (1980), nationalisations (1982), presse (1984), découpage, mode de scrutin (1985…), privatisations (1986), référendum (1987), droits sociaux des étrangers (1990), tout n’est plus possible. Et, au-delà de ces décisions spectaculaires, le Conseil contrôle aussi les élections ou la procédure budgétaire. L’analyse de ces domaines méconnus complète, avec tableaux, bibliographies et bilans, un dossier indispensable sur une des pièces
maîtresses de la Ve République.
Pouvoirs n°13 – avril 1980 // nouvelle édition juillet 1991 – 22
_ ISBN 2 13 044020 7 ISSN n° 0152 0768
Sommaire
Pierre AVRIL, Olivier DUHAMEL
Introduction
Jean RIVERO
Fin d’un absolutisme
Louis FAVOREU
L’apport du Conseil constitutionnel au droit public
Jean BOULOUIS
Le défenseur de l’Exécutif
Danièle LOCHAK
Le Conseil constitutionnel protecteur des libertés ?
Pierre LALUMIÈRE
Un domaine nouveau de l’intervention du Conseil constitutionnel : les dispositions constitutionnelles à caractère financier et budgétaire
Loïc PHILIP
Le Conseil constitutionnel juge électoral
Michel CHARASSE
Saisir le Conseil constitutionnel. La pratique du groupe socialiste de l’Assemblée nationale (1974-1979)
René CHIROUX
Faut-il réformer le Conseil ?
Alfred GROSSER
Cours constitutionnelles et valeurs de référence. A propos de décisions sur l’avortement
René de LACHARRIÈRE
Opinion dissidente
Gérard SACCONE
Bilans
Louis FAVOREU
Le Conseil constitutionnel et le Président de la République dans le cadre de l’alternance (1981-1986)
Dominique ROUSSEAU
Le Conseil constitutionnel (1986-1991). Vie de l’institution et politiques jurisprudentielles
Georges VEDEL