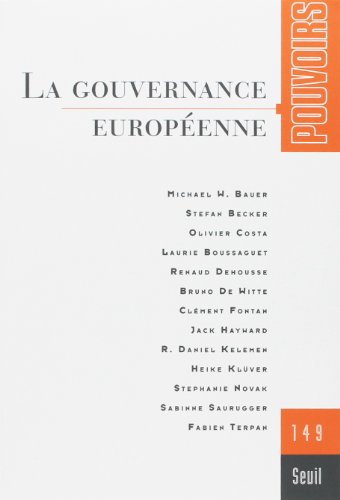Bruno DE WITTE
Union européenne, zone Euro : quels gouvernements
Pouvoirs n°149 - La gouvernance européenne - avril 2014 - p.45-58
L’autonomie institutionnelle de la zone euro par rapport à l’ensemble de l’Union européenne est davantage marquée depuis le début de la crise des dettes souveraines. Des organes intergouvernementaux nouveaux et informels (l’Eurogroupe et le Sommet de la zone euro) ont été nidifiés au sein du système institutionnel de l’Union européenne. Par ailleurs, les États de la zone euro ont conclu entre eux des traités et accords internationaux pour renforcer leur coopération en dehors du cadre institutionnel de l’Union. Cette autonomie institutionnelle reste cependant limitée, et les projets visant à développer une coopération plus poussée dans un cadre institutionnel propre à la zone euro resteront difficiles à réaliser.